

À mon fils Samuel,
mon paradis sur terre, source d'inspiration et de joie inépuisable.
À ma chère Florence,
pilier de ma vie.
À ma mère Simone et à mon père Michel,
qui m'ont enseigné la persévérance.
À ma famille.
À mes amis Charlotte et Rémi,Gilles,Jean-Christrophe, Jean Ronald, Léon, Manu, Pascal,
À Sara, petite amie de Samuel,
À mes collègues de travail,
pour les moments de partage et d'amitié.
À mes élèves,
qui ont été une source de motivation et de renouvellement,
m'inspirant par leur curiosité et leur détermination.
À mes anciens professeurs,
pour avoir semé les graines de la connaissance et de la passion pour la géométrie,
qui fleurissent tout au long de ma vie.
Et enfin, à – la géométrie – Reine de la rigueur, de la création,la réflexion,
de la beauté de l'ordre, de la puissance de la logique, et de l'art.
Ce livre est le fruit de toutes vos influences.
Qu'il soit un témoignage de ma gratitude envers chacun de vous.
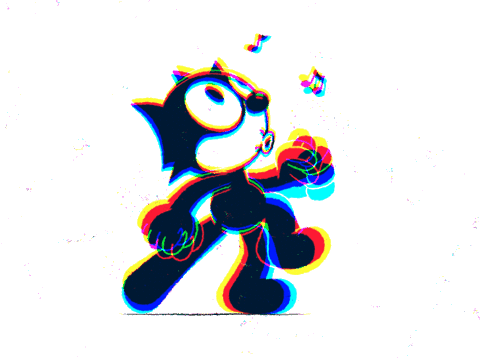
On se place dans un ensemble IP dont les éléments sont appelés points, et la réunion de certains points sont appelés des droites.
Cette ensemble IP vérifie les axiomes suivants :
Axiome I1 : Etant donné une droite, il existe au moins deux points distincts sur cette droite.
Axiome I2 : Etant donné deux points A et B distincts, il existe une unique droite passant par A et B.
Définition : On dit que trois points sont alignés, il existe une droite passant par ces trois points.
Axiome I3 : Il existe trois points non alignés.
Définition : On note (AB) ou (BA) l'unique droite passant par les deux points distincts A et B.
Définition : Deux droites sont parallèles si elles n’ont aucun point en commun ou si elles sont confondues.
Propriété PI1 (I1, I2) : Si deux droites distinctes sont non parallèles, alors elles ont un unique point en commun.
Démonstration de PI1 :
Soient (d) et (d’) deux droites distinctes et non parallèles.
Donc par définition, elles ont au moins un point A en commun.
D'après l'axiome I1, il existe un autre point sur (d) et un autre point sur(d').
Si elles avaient un autre point B en commun, alors d’après l’axiome I2, les droites (d) et (d’) seraient confondues.
Ce qui absurde, car (d) et (d’) sont distinctes.
Donc (d) et (d’) ont un unique point en commun.
CQFD
Propriété PI2 (I2, I3) : Pour tout point, il existe au moins une droite ne passant pas par ce point.
Démonstration de PI2 :
Soit M un point.
D’après l’axiome I3, il existe trois points A, B et C distincts et non alignés.
1er Cas : Si M∉(AB).
Alors la droite (AB) convient.
2ième Cas : Si M∈(AB) et si M ≠ A.
Alors la droite (AC) convient.
Car si (AC) passe par M, alors (AB) et (AC) ont les points A et M en commun, et donc d’après l’axiome I2, les points A, B et C sont alignés. Ce qui est contradictoire.
3ième Cas : Si M = A
Alors la droite (BC) convient, car les points A, B et C ne sont pas alignés.
CQFD
Propriété PI3 (I3) : Pour toute droite, il existe au moins un point ne lui appartenant pas.
Démonstration de PI3 :
Soit (d) une droite.
D’après l’axiome I3, il existe trois points A, B et C distincts et non alignés.
Donc un des trois points ne peut appartenir à (d).
CQFD
Propriété PI4 (I2, I3) : Pour tout point, il existe au moins deux droites distinctes auxquelles ce point appartient.
Démonstration de PI4 :
Soit M un point,d’après l’axiome I3, il existe trois points A, B et C distincts et non alignés.
Donc M ne peut être égal à la fois, aux points A, B et C.
1er Cas : A = M. De même si B = M ou C = M.
Donc le point M appartient aux droites (BM) et (CM).
Les droites (BM) et (CM) sont distinctes car sinon d'après l'axiome I2, les points A, B et C seraient alignés.
2ième Cas : Si M est distinct des points A, B et C.
Les droites (AM), (BM) et (CM) ne peuvent être la même droite car sinon les points A, B et C seraient alignés. Donc le point M appartient à au moins deux droites distinctes.
CQFD
L’ensemble IP est muni d’une relation ternaire * telle que si A, B et C sont trois points, on note A*B*C le fait que A, B et C sont distincts, alignés, et B est entre A et C.
Définition : Si A et B sont deux points distincts, alors on appelle segment [AB] ou [BA] l’ensemble formé par les points A et B, et les points M tel que A*M*B. Le point A, peut-être vu comme le segment [AA].
Définition : Si A et B sont deux points distincts. On appelle demi-droite [AB) ou (BA], l’ensemble formé par les points A et B, et les points M tel que A*M*B ou A*B*M.
Axiome O1 : Si A*B*C alors C*B*A.
Axiome O2 : Etant donné deux points distincts B et D, il existe des points A, C, E appartenant à la droite (BD) tels que A*B*D, B*C*D et B*D*E.
Axiome O3 : Si A, B, C sont trois points distincts appartenant à la même droite, alors un et un seul est entre les deux autres.
Définition : Soient (d) une droite, et A et B deux points distincts n’appartenant pas à (d).
(1) Si [AB]⋂(d)=∅, alors on dit que les points A et B sont du même côté de (d).
(2) Si [AB]⋂(d)≠∅, alors on dit que les points A et B sont de part et d’autre de (d).
(3) Dans le cas où A=B, on dit que les points A et B sont du même côté de (d).
Axiome O4 : Pour toute droite (d), et tout triplet de points A, B, C non situés sur (d) :
(1) Si A et B sont d'un même côté de (d), et B et C aussi, alors A et C sont du même côté de (d).
(2) Si A et B sont de part et d'autre de (d), et B et C aussi, alors A et C sont d'un même côté de (d).
Propriété PO1 (O3) : Si A et B deux points distincts, alors [AB)⋂[BA) = [AB] et [AB)⋃[BA) = (AB).
Démonstration de PO1 :
Soient A et B deux points distincts.
M∈[AB)⋂[BA)
<=> M∈[AB) et M∈[BA)
<=> (M= A ou M= B ou A*M*B ou A*B*M) et (M=A ou M = B ou A*M*B ou B*A*M)
<=> M=A ou M = B ou A*M*B d’après l’axiome O3
<=> M∈[AB]
M∈[AB)⋃[BA)
<=> M∈[AB) ou M∈[BA)
<=> (M= A ou M= B ou A*M*B ou A*B*M) ou (M= A ou M = B ou A*M*B ou B*A*M)
<=> M=A ou M=B ou A*M*B ou A*B*M ou B*A*M
<=> M∈(AB)
CQFD
Définition : Soient A, B et C trois points distincts. Si B*A*C alors on dit les demi-droites [AB) et [AC) sont opposées.
Propriété PO2 (O2, O3) :
(1) Deux demi-droites opposées sont distinctes.
(2) Toute demi-droite admet une demi-droite opposée.
Démonstration de PO2 :
(1) Soient A, B et C trois points distincts tel que B*A*C.
Montrons que les demi-droites [AB) et [AC) opposées sont distinctes.
Supposons que C∈[AB)
Donc C=A ou C= B ou A*C*B ou A*B*C
Or A, B et C trois points distincts tels que B*A*C
Donc d’après l’axiome O3, ceci est absurde.
Donc les demi-droites [AB) et [AC) sont opposées.
CQFD
(2) Soient A et B deux points distincts.
D’après l’axiome O2, il existe un point C tel que B*A*C.
Donc la demi-droite [AB), admet [AC) comme demi-droite opposé.
CQFD
Définition : On appelle demi-plan (PA,d) défini par la droite (d) et un point A n’appartenant pas à (d), l’ensemble des points qui sont du même côté que le point A par rapport à (d).
Propriété PO3 (O2,O4,PI1,PI3 ) :
(1) Toute droite (d) détermine deux demi-plans qui n’ont aucun point commun, et tout point n’appartenant pas à (d) est dans un de ces demi-plans.
(2) Si A et B sont de part et d’autre de (d), alors (d) détermine les demi-plans (PA,d) et (PB,d).

Démonstration de PO3 :
Soit (d) une droite.
D’après la propriété PI3, il existe au moins un point A n’appartenant pas à (d).
A et (d) définissent le demi-plan (PA,d)
Soit I un point de (d).
I ≠A car A(d)
Donc la droite (AI) est bien définie.
D’après l’axiome O2, il existe un point B sur (AI) tel que A*I*B.
Donc les points A et B sont de part et d’autre de (d), et A ≠ B.
(AI) et (d) sont deux droites distinctes et non parallèles car A(d) et I∈(d)
Donc d’après la propriété PI1, (AI) et (d) ont un unique point en commun, soit I.
Si B∈(d) comme B∈(AI), alors B = I.
Ce qui est contradictoire car A*I*B, soit en particulier B≠I.
Donc B(d)
Donc B et (d) définissent le demi-plan (PB,d)
Soit M∈(PA,d)
Donc A et M sont du même côté par rapport à (d)
Si B =M alors A et B sont du même côté par rapport à (d) et A ≠B.
Ce qui est contradictoire avec les points A et B sont de part et d’autre de (d), et A ≠ B.
Donc B≠M.
Si B et M sont du même côté par rapport à (d), alors d’après Axiome O4(1), A et B sont du même côté.
Ce qui est contradictoire car les points A et B sont de part et d’autre de (d), et A≠B.
Donc B et M sont de part et d’autre par rapport à (d), et B≠M.
Donc M(PB,d).
De même, si M∈(PB,d), alors M(PA,d).
Donc (PA,d) et (PB,d) n’ont aucun point commun.
Reste à démontrer que tout point C n’appartenant pas à (d), appartient à (PA,d) ou à (PB,d).
1er Cas : Si C = A
Alors C∈(PA,d), car A et A sont du même côté par rapport à (d).
2ième Cas : Si C≠A et [AC]⋂(d)=∅
Alors les points A et C sont du même côté de (d).
Donc C∈(PA,d).
3ième Cas : Si C≠A et [AC]⋂(d)≠∅
Donc A et C sont de part et d’autre par rapport à (d)
Mais comme les points A et B sont de part et d’autre de (d), d’après l’axiome O4(2), les points A et C sont du même côté de (d).
Donc C∈(PB,d).
CQFD
Propriété PO4_Pasch(O4, PO3) ou Postulat de Pasch : Si ABC est un triangle, et (d) une droite coupant le segment [AB], alors (d) coupe aussi [AC] ou [BC].

Démonstration de PO4_Pasch :
1er Cas : Si C∈(d)
Donc (d) coupe aussi [AC] et [BC] en C.
2ième Cas : Si C(d)
A≠B et [AB]⋂(d)≠∅ donc A et B sont de part et d’autre de (d).
Donc d’après la propriété PO3, C∈(PA,d) ou C∈(PB,d)
1er Sous cas : si C∈(PA,d)
Donc A et C sont du même côté par rapport à (d).
Si B et C étaient du même côté par rapport à (d), alors d’après axiome O4, A et B seraient du même côté par rapport à (d). Ce qui est contradictoire avec A et B sont de part et d’autre de (d).
Donc B et C sont de part et d’autre de (d).
Donc [BC]⋂(d)≠∅
Donc (d) coupe le segment [BC]
2ième sous cas : Si C∈(PB,d)
De même, on démontre que (d) coupe le segment [AC].
CQFD
Propriété PO5 (O3, PI1) : Si (d) une droite, A et B sont deux points tels que A∈(d) et B(d), alors ]AB) ⊂ (PB,d).

Démonstration de PO5 :
M∈]AB) donc A*M*B ou M=B ou A*B*M
1er Cas : M=B
Alors [MB]⋂(d)={B}⋂(d)=∅ car B(d).
Donc M et B sont du même côté par rapport à (d).
Donc M∈(PB,d).
2ième Cas : Si A*M*B et M≠B
Supposons que [MB]⋂(d)≠∅
Comme A*M*B, alors A, M et B sont distincts et alignés.
Et comme aussi A∈(d), A∈(MB) et B(d), alors d’après la propriété PI1, (MB)⋂(d)={A}
[MB]⋂(d)≠∅
Donc A∈[MB], et A, M et B sont distincts.
Donc M*A*B.
Or A*M*B, ce qui est contradictoire avec l’axiome O3.
Donc [MB]⋂(d)=∅ et M≠B.
Donc M et B sont du même côté par rapport à (d).
Donc M∈(PB,d).
3ième Cas : Si A*B*M et M≠B
Supposons que [MB]⋂(d)≠∅
Comme A*B*M, alors A, M et B sont distincts et alignés.
Et comme aussi A∈(d) , A∈(MB) et B(d), alors d’après la propriété PI1, [MB]⋂(d)={A}
[MB]⋂(d)≠∅
Donc A∈[MB], et A, M et B sont distincts.
Donc M*A*B.
Or A*B*M, ce qui est contradictoire avec l’axiome O3.
Donc [MB]⋂(d)=∅ et M≠B.
Donc M et B sont du même côté par rapport à (d).
Donc M∈(PB,d).
CQFD
Propriété PO6 (I2,O3, PI1, PI3, PO3, PO5) : Si B*A*C, alors (BC)=[AB)⋃[AC) et [AB)⋂[AC)={A}.

Démonstration de PO6 :
B*A*C donc il existe une droite (d) tels que A, B et C appartiennent à (d).
D’après la propriété PI3, il existe un point D n’appartenant pas à (d).
A≠D, donc notons (d’) la droite (AD)
D(d) donc (d) et (d’) sont distinctes.
A∈(d), A∈(d’) et D(d).
Donc d’après la propriété PI1, (d)⋂(d’)={A}
Si [BC]⋂(d’)=∅, comme A∈(d’), alors A[BC]. Ce qui est contradictoire avec B*A*C.
Donc [BC]⋂(d’)≠∅.
B*A*C donc B≠C.
Donc B et C sont de part et d’autre par rapport à (d’).
Donc d’après la propriété PO3, (d’) détermine les demi-plans (PB,d’) et (PC,d’)
Soit M∈(BC)
1er Cas : Si M=A
A∈[AB)et A∈[AC) donc A∈[AB)⋃[AC) donc M∈[AB)⋃[AC)
2ième Cas : Si M≠A
(BC)=(d), (d)⋂(d’) ={A}donc M(d’)
Donc d’après la propriété PO3, M∈(PB,d’) ou M∈(PC,d’)
1er sous cas : si M∈(PB,d’)
Donc M et B sont du même côté par rapport à (d’)
M, A et B appartiennent à (d) donc M=B ou d’après l'axiome O3, M*A*B ou A*M*B ou A*B*M
Si M=B, alors M∈[AB).
Si M≠B et M*A*B, alors M et B sont de part et d’autre de (d’). Ce qui est contradictoire.
Si M≠B et A*M*B, alors M∈[AB], donc M∈[AB).
Si M≠B et A*B*M, alors par définition, M∈[AB).
2ième sous cas : si M∈(PC,d’)
De même, on démontre que M∈[AC).
Donc M∈(BC) M∈[AB)⋃[AC)
Donc (BC) ⊂[AB)⋃[AC)
B*A*C donc B, A et C sont distincts et alignés
Donc d’après l'axiome I2, (BC)=(AB)=(AC)
[AB)⊂(AB)=(BC) et [AC)⊂(AC)=(BC) donc [AB)⋃[AC)⊂(BC)
Donc (BC)=[AB)⋃[AC).
Enfin d’après la propriété PO5, ]AB) ⊂ (PB,d’) et ]AC) ⊂ (PC,d’)
D’après la propriété PO3, (PB,d’) ⋂ (PC,d’) = ∅
Donc ]AB)⋂]AC) = ∅.
Donc [AB)⋂[AC)={A}.
CQFD
Propriété PO7 (I2,O3,O4,PI1,PI3) : Si A*B*C et A*C*D, alors B*C*D et A*B*D.
Démonstration de PO7 :
A*B*C et A*C*D, donc A, B, C et D sont alignés d’après l'axiome I2.
D’après la propriété PI3, il existe un point M n’appartenant pas à (AB).
A*C*D donc A et D sont de part et d’autre de (CM).
Si B et A étaient de part et d’autre de (CM), alors A*C*B ce qui est contradictoire avec A*B*C d’après l'axiome O3.
Donc A et B sont du même côté par rapport à (CM).
Donc B et D sont de part et d’autre de (CM) d’après O4.
Donc d’après la proriété PI1, B*C*D.
A*B*C donc A et C sont de part et d’autre de (BM).
Si C et D étaient de part et d’autre de (BM), alors C*B*D ce qui est contradictoire avec B*C*D d’après l'axiome O3.
B*C*D donc C et D sont du même côté par rapport à (BM).
Donc d’après l'axiome O4, A et D sont de part et d’autre de (BM).
Donc d’après la propriété PI1, A*B*D.
CQFD
Propriété PO8 (I2,O3,O4,PI1,PI3) : Si A*B*C et B*C*D, alors A*B*D et A*C*D.
Démonstration de PO8 :
A*B*C et B*C*D, donc A, B, C et D sont alignés d’après l'axiome I2.
D’après la propriété PI3, il existe un point M n’appartenant pas à (AB).
A*B*C donc A et C sont de part et d’autre de (BM).
Si C et D étaient de part et d’autre de (BM), alors C*B*D ce qui est contradictoire avec B*C*D d’après l'axiome O3.
B*C*D donc C et D sont du même côté par rapport à (BM).
Donc d’après l'axiome O4, A et D sont de part et d’autre de (BM).
Donc d’après la propriété PI1, A*B*D.
Si A et B étaient de part et d’autre de (CM), alors A*C*B ce qui est contradictoire avec A*B*C d’après l'axiome O3.
A*B*C donc A et B sont du même côté par rapport à (CM).
B*C*D donc B et D sont de part et d’autre de (CM).
Donc d’après l'axiome O4, A et D sont de part et d’autre de (CM).
Donc d’après la propriété PI1, A*C*D.
CQFD
L’ensemble IP est muni d’une relation de congruence sur les segments, notée ≅ .
Axiome C1 : Si A et B sont deux points distincts et A' un point quelconque, pour toute demi-droite [d) d'origine A',alors il existe un point unique B’ de [d) tel que B'≠ A' et [AB] ≅ [A'B'].
Axiome C2 : Si [AB] ≅ [CD] et [AB] ≅ [EF], alors [CD] ≅ [EF]. Tout segment est congru à lui-même.
Axiome C3 : Si A*B*C, A'*B'*C', [AB] ≅ [A'B'], et [BC] ≅ [B'C'], alors [AC] ≅ [A'C'] (addition).
Propriété PC1 (C1,C2,C3,O4,PI1,PI3,PO5):
(1) Si A*B *C, A’*B’*C’, [AB] ≅ [A’B’] et [AC] ≅ [A’C’], alors [BC] ≅ [B’C’] (Soustraction).
(2) Si [AC] ≅ [DF] et un point B tel que A*B*C, alors il existe un unique point E, tel que D*E*F et [AB] ≅ [DE].
Démonstration de PC1 :
(1) Soient A*B *C, A’*B’*C’, [AB] ≅ [A’B’] et [AC] ≅ [A’C’]
D’après l’axiome C1, il existe un point unique C’’ de [B’C’) tel que C’'≠ B' et [BC] ≅ [B'C''].
D’après la propriété PI3, il existe un point M n’appartenant pas à (B’C’).
Donc d’après la propriété PO5, ]B’C’) ⊂ P(C’,(B’M))
C’’est un point de [B’C’) et C’'≠ B' donc C’’∈ P(C’,(B’M))
Donc C’et C’’ sont du même côté par rapport à la droite (B’M)
A’*B’*C’donc A’ et C’sont de part et d’autre de (B’M)
Donc d’après l'axiome O4, A’ et C’’ sont de part et d’autre de (B’M).
Donc d’après la propriété PI1, A’*B’*C’’.
A*B *C, A’*B’*C’’, [AB] ≅ [A’B’] et [BC] ≅ [B’C’’]
Donc d’après l'axiome C3, [AC] ≅ [A'C'’]
A’*B’*C’ donc C’ et B’ sont du même côté par rapport à la droite (A’M).
A’*B’*C’’ donc C’’ et B’ sont du même côté par rapport à la droite (A’M).
Donc d’après l'axiome O4, C’ et C’’ sont du même côté par rapport à la droite (A’M).
A’*B’*C’ et A’*B’*C’’ donc A’, B’, C’ et C’’ sont alignés
Donc C’’∈ [A’C’)
C’’∈ [A’C’) tel que C’'≠ A' et [AC] ≅ [A'C''].
C’ ∈ [A’C’) tel que C'≠ A' et [AC] ≅ [A'C'].
Donc d’après l’unicité de l'axiome C1, C’= C’’
Et donc [BC] ≅ [B'C'].
(2) [AC] ≅ [DF] donc d’après l’axiome C1, il existe un unique point E sur la demi-droite [DF) tel que E≠D et [AB] ≅ [DE].
Il reste à démontrer que D*E*F.
D’après l’axiome C1, il existe F’ tel que D*E*F’ et [EF’] ≅ [BC]
A*B*C, D*E*F’, [AB] ≅ [DE] et [EF’] ≅ [BC] Donc d’après l’axiome C3 on : [DF’] ≅ [AC].
[DF’] ≅ [AC] et [AC] ≅ [DF] donc d’après l’axiome C2, on a : [DF’] ≅ [DF’]
Donc d’après l’axiome C1, on a : F = F’.
D*E*F’ et F = F’ donc D*E*F.
CQFD
L’ensemble IP est muni d’une relation sur les segments, notée < et > telle que : [AB] < [CD] ou [CD] > [AB] si ∃E \ C*E*D et [AB] ≅ [DE].
Propriétés PC2 (C1,C2,O3,PC1,PO7) : Si A et B, C et D, E et F sont des couples de points distincts, alors :
(1) Quels que soient deux segments [AB] et [CD], une seule des trois conditions suivantes est vraie :
[AB] < [CD] ; [AB] ≅ [CD] ; [CD] < [AB].
(2) Si [AB] < [CD] et [CD] ≅ [EF], alors [AB] < [EF].
(3) Si [AB] > [CD] et [CD] ≅ [EF], alors [AB] > [EF].
(4) Si [AB] < [CD] et [CD] < [EF], alors [AB] < [EF].
Démonstration de PC2 :
(1) D'après l'axiome C1, il existe un point E unique sur la demi-droite [AB) telle que A≠E et [AE] ≅ [CD].
1er Cas : Si E=B,
[AE] ≅ [CD] donc [AB] ≅ [CD].
2ième Cas : Si E≠B
A≠B, A≠E et B≠E donc d’après l’axiome O3, on a : E*A*B ou A*E*B ou A*B*E
E appartient sur la demi-droite [AB) donc on ne peut avoir E*A*B.
Donc si on a : A*E*B, alors [CD] < [AB].
Et si on a : A*B*E, alors [AB] < [CD].
Les cas E≠B, A*E*B et A*B*E ne pouvant être des cas communs.
Une seule des trois conditions suivantes est vraie : [AB] < [CD] ; [AB] ≅ [CD] ; [CD] < [AB].
(2) D’après le (1), [AB] et [EF], une seule des trois conditions suivantes est vraie : [AB] < [EF] ; [AB] ≅ [EF] ; [EF] < [AB].
1er cas : si [AB] ≅ [EF]
[AB] ≅ [EF] et [CD] ≅ [EF] donc [AB] ≅ [CD] ce qui est impossible d’après (1) car [AB] < [CD] et une seule des trois conditions suivantes est vraie : [AB] < [CD] ; [AB] ≅ [CD] ; [CD] < [AB].
2ième Cas : si [EF] < [AB]
[EF] < [AB] donc il existe un unique point B’ tel que A*B’*B et [AB’] ≅ [EF].
[AB] < [CD] donc il existe un unique point C’ tel que C*C’*D et [CC’] ≅ [AB].
[CC’] ≅ [AB’] donc [AB’] ≅ [CC’]
et on a : A*B’*B
D'après la propriété PC1(2), il existe un point C’’ telle que C*C’’*C’ et [CC’’] ≅ [AB’].
C*C’’*C’ et C*C’*D donc d’après la propriété PO7, on a : C*C’’*D.
[CC’’] ≅ [AB’] et [AB’] ≅ [EF] donc d’après l’axiome C2, on a : [CC’’] ≅ [EF].
Donc il existe un point C tel que C*C’’*D et [CC’’] ≅ [EF].
Donc [EF] < [CD]
Ce qui est impossible car [EF] ≅ [CD] et une seule des trois conditions suivantes est vraie : [EF] < [CD] ; [EF] ≅ [CD] ; [EF] < [CD].
3ième Cas : [AB] < [EF]
Ce cas est nécessairement vrai car une seule des trois conditions suivantes est vraie : [AB] < [EF] ; [AB] ≅ [EF] ; [EF] < [AB] et [AB] ≅ [EF] ; [EF] < [AB] sont fausses.
(3)[AB] > [CD] donc il existe un point B’ tel que A*B’*B et [AB’] ≅ [CD].
[AB’] ≅ [CD] et [CD] ≅ [EF] donc d’après l’axiome C2, on a : [AB’] ≅ [EF]
Donc il existe un point B’ tel que A*B’*B et [AB’] ≅ [EF].
Donc [AB] > [EF].
(4) [AB] < [CD] donc il existe un point C' tel que C*C'*D et [CC'] ≅ [AB].
[CD] < [EF] donc il existe un point F' tel que E*F'*F et [EF'] ≅ [CD].
[AB] < [CD] et [CC'] ≅ [AB] donc d’après (3), on a : [CC’] < [CD]
[CC’] < [CD] et [EF'] ≅ [CD] donc d’après (2), on a : [CC’] < [EF’]
[CC’] < [EF’] et [CC'] ≅ [AB] donc d’après (3), on a : [AB] < [EF’]
[AB] < [EF’] donc il existe un point F’' tel que E*F’'*F’ et [EF'’] ≅ [AB].
E*F’'*F’ et E*F'*F donc d’après la propriété PO7, on a : E*F’’*F
Donc il existe un point F’’ tel que E*F’’*F et [EF'’] ≅ [AB].
Donc [AB] < [EF’].
CQFD
Définition : On appelle angle ∠BAC, l’ensemble de deux demi-droites de même origine [AB) et [AC) qui ne sont ni opposées, ni confondues.
L’ensemble IP est muni d’une relation de congruence sur les angles, notée aussi ≅ .
Axiomes C4 : Pour tout angle ∠BAC et toute demi-droite [A'B), il existe une unique demi-droite [A'C') qui soit d'un côté donné de (A'B') et telle que ∠B’A’C’ ≅ ∠BAC.
Axiomes C5 : Si ∠A ≅ ∠B, et ∠B ≅ ∠C, alors ∠A ≅ ∠C. Et tout angle est congru à lui-même.
Définition : On dit que deux triangles ABC et A'B'C' sont congruents si [AB] ≅ [A'B'], [BC] ≅ [B'C'], [AC] ≅ [A'C'], ∠A ≅∠A’, ∠B≅ ∠B’ et ∠C ≅∠C’.
Axiomes C6 : Si deux triangles ont un angle congruent compris entre deux côtés congruents, alors ces deux triangles sont congruents.
Propriétés PC3 (C6) : Si un triangle est isocèle, alors ces angles à sa base sont égaux.
Démonstration de PC3 :
Soit ABC un triangle tel que : [AB] ≅ [AC], montrons que ∠B ≅ ∠C.
∠BAC ≅ ∠CAB, [AB] ≅ [AC] et [AC] ≅ [AB], donc d’après l’axiome C6, on a : les triangles ABC et ACB sont congruents.
Donc ∠B ≅ ∠C. CQFD
Propriété PC4 (C3,C6) :
(1) Les angles supplémentaires d’angles congruents sont congruents.
(2) Les angles opposés par le sommet sont congruents.
Démonstration de PC4 :
(1)

Soient A, B, C, D et A’, B’, C’, D’ tels que B*A*C et B’*A’*C’, et ∠BAD ≅ ∠B’A’D’.
On peut poser aussi, sans restreindre les hypothèses que [AB] ≅ [A'B'], [AC] ≅ [A'C'], [AD] ≅ [A'D'].
[AB] ≅ [A'B'], [AD] ≅ [A'D'], ∠BAD ≅ ∠B’A’D’
Donc d’après l’axiome C6, on a : les triangles BAD et B’A’D’ sont congruents.
Donc [BD] ≅ [B'D'] et ∠ABD ≅ ∠A’B’D’.
[AB] ≅ [A'B'] donc [BA] ≅ [B'A’]
B*A*C et B’*A’*C’, [BA] ≅ [B'A’] et [AC] ≅ [A'C'] donc d’après l’axiome C3, on a : [BC] ≅ [B'C’].
∠ABD ≅ ∠A’B’D’ donc ∠CBD ≅ ∠C’B’D’ car, puisque B*A*C et B’*A’*C’, [BA) et [BC) sont la même demi-droite, de même pour [B’A’) et [B’C’)
[BC] ≅ [B'C’] et [BD] ≅ [B'D'] et ∠CBD ≅ ∠C’B’D’
Donc d’après l’axiome C6, on a : les triangles CBD et C’B’D’ sont congruents.
Donc [CD] ≅ [C'D'] et ∠BCD ≅ ∠B’C’D’.
[AC] ≅ [A'C'] donc [CA] ≅ [C'A'].
∠BCD ≅ ∠B’C’D’ donc ∠ACD ≅ ∠A’C’D’ car, puisque B*A*C et B’*A’*C’, [CA) et [CB) sont la même demi-droite, de même pour [C’A’) et [C’B’)
[CA] ≅ [C'A'] et [CD] ≅ [C'D'] et ∠ACD ≅ ∠A’C’D’
Donc d’après l’axiome C6, on a : les triangles ACD et A’C’D’ sont congruents.
Donc ∠DAC ≅ ∠D’A’C’.
(2)

Soient deux angles ∠AOB et ∠A’OB’ tels que A*O*A’ et B’*O*B’.
∠AOB et ∠A’OB’ sont tous les deux supplémentaires à ∠AOB’ donc d’après (1), ils sont congruents.
CQFD
Propriété PC5 () : Si deux droites sont coupées par une troisième droite, et si les angles alternes-internes formés sont congruents, alors les droites sont parallèles.
Démonstration de PC5 :
 ...
...
Axiome Dkp_segment Dedekind segment ouvert : Si l'ensemble des points de ]AB[ est la réunion de deux parties non vides Σ1 et Σ2 telles que aucun point de Σ1 n'est entre deux points de Σ2, et vice-versa alors, il existe un point O appartenant à ]AB[ tel que pour tous points M1 et M2 de ]AB[ autres que O, on a M1*O*M2 si et seulement si M1 appartient à Σ1 et M2 appartient à Σ2.
Propriété Dkd1 (Dkp_segment,O1,O2,O3,PO7,PO8): L’axiome de Dedekind implique que : Σ1⋂Σ2 ⊂{O}.
Démonstration de Ddk1 :
D'après l'axiome Dkp_segment :
O∈]AB[ donc A*O*B
Supposons que M∈Σ1⋂Σ2 avec M ≠ O.
M∈Σ1⋂Σ2=]AB[ donc A*M*B
D’après l’axiome O3, on a : M*A*O ou A*M*O ou A*O*M
1er cas : si M*A*O
M*A*O et A*O*B donc d’après la propriété PO8, on a : M*A*B.
Ce qui est impossible d’après l’axiome O3, car A*M*B.
2ième Cas : si A*M*O
D’après l’axiome O2, il existe un point M’ tel que O*M’*B.
A*O*B et A*M*O donc d’après la propriété PO7, on a : M*O*B.
O*M’*B et M*O*B donc d’après l’axiome O1, on a : B*M’*O et B*O*M.
B*M’*O et B*O*M donc d’après la propriété PO7, on a : M’*O*M.
M’*O*M donc d’après l’axiome O1, on a : M*O*M’.
M∈Σ1⋂Σ2 donc M∈Σ1
M*O*M’ et M∈Σ1 donc M’∈Σ2
M∈Σ1⋂Σ2 donc M∈Σ2
M*O*M’ et M∈Σ2 donc M’∈Σ1
O∈]AB[ , et ]AB[ = Σ1⋃Σ2 donc O∈Σ1 et/ou O∈Σ2.
Si O∈Σ1, alors M*O*M’, M∈Σ2, O∈Σ1 et M’∈Σ2.
Si O∈Σ2, alors M*O*M’, M∈Σ1, O∈Σ2 et M’∈Σ1.
Ce qui est impossible car d'après l'axiome Dkp_segment : aucun point de Σ1 n'est entre deux points de Σ2, et vice-versa.
3ième cas : si A*O*M
A*O*M et A*O*B donc d’après la propriété PO7, on a : O*M*B.
O*M*B donc d’après l’axiome O1, on a : B*M*O.
Ceci revient à faire le 2ième cas.
Donc c’est impossible.
CQFD
Propriété Dkd2 (Dkp_segment,O1,O2,O3,PO7,PO8): Dans l’axiome de Dedekind, le point O est unique.
Démonstration de Ddk2 :
Supposons qu’il existe deux points O1 et O2 candidats pour être le point O tel que défini par l’axiome Dkp_segment.
O1∈]AB[ donc A*O1*B
O2∈]AB[ donc A*O2*B
Donc d’après l’axiome O3, on : A*O1*O2 ou O1*A*O2 ou O1*O2*A.
1er CAS : si O1*A*O2
O1*A*O2 et A* O2*B, donc d’après la propriété PO7, on a : O1*A*B.
Donc A*O1*B et O1*A*B, ce qui est impossible d’après l’axiome O3.
2ième CAS : si A*O1*O2
(le cas O1*O2*A est le même cas, car on peut inverser les notations de O1 et O2)
D’après l’axiome O2, appliqué à la droite (AB) et aux points A et O1 :
Il existe un point E te que A*E*O1.
D’après l’axiome O2, appliqué à la droite (AB) et aux points O1 et O2 :
Il existe un point F te que O1*F*O2.
D’après l’axiome O2, appliqué à la droite (AB) et aux points O2 et B :
Il existe un point G te que O2*G*B.
A*E*O1 et A*O1*O2 donc d’après la propriété PO7, on a : E*O1*O2.
E*O 1*O2 et O1*F*O2 donc d’après l’axiome O1, on a : O2* O1*E et O2*F*O1.
O2*O1*E et O2*F*O1 donc d’après la propriété PO7, on a : F*O1*E.
F*O1*E donc d’après l’axiome O1, on a : E*O1*F.(*)
O2*G*B et A*O2*B et donc d’après l’axiome O1 , on a : B*G*O2 et B*O2*A.
B*G*O2 et B*O2*A donc d’après la propriété PO7, on a : G*O2*A.
G*O2*A donc d’après l’axiome O1 , on a : A*O2*G.
A* O1* O2 et A*O2*G et donc d’après la propriété PO7, on a : O 1* O 2*G.
O1*F*O2 et O1*O2*G donc d’après la propriété PO7, on a : F*O2*G.(**)
Si, par exemple, on a : E∈Σ1, donc d’après (*), on a : F∈Σ2.
F∈Σ2 donc d’après (**), on a : G∈Σ1
O1*F*O2 et E*O1*O2 donc d’après l’axiome O1, on a : O2*F*O1 et O2*O1*E.
O2*F*O1 et O2*O1*E donc d’après la propriété PO7, on a : O2*F*E.
O2*F*E donc d’après l’axiome O1, on a : E*F*O2.
E*F*O2 et F*O2*G donc d’après la propriété PO8, on a : E*F*G.
Ce qui est impossible car aucun point de Σ1 n'est entre deux points de Σ2, et vice-versa.
Donc nous avons bien l’unicité du point O dans l’axiome Dkp_segment.
CQFD
Propriété Dkd3 : Axiome de Dedekind sur la droite
Si l’ensemble des points d’une droite (d) soit la réunion Σ1 et Σ2 de deux parties non vides et telles que aucun point de Σ1 ne soit entre deux points de Σ2 et vice-versa, alors il existe un point O de (d) tel que pour tous points M1 et M2 de (d) autre que O, on ait M1*O*M2 si et seulement si M1∈Σ1 et M2∈Σ2.
Démonstration de Ddk3 :
Soient M1∈Σ1 et M2∈Σ2
Axiome de Dedekind :
Si l’ensemble des points d’une droite (d) soit la réunion Σ1 et Σ2 de deux parties non vides et telles que aucun point de Σ1 ne soit entre deux points de Σ2 et vice-versa, alors il existe un point O de (d) tel que pour tous points M1 et M2 de (d) autre que O, on ait M1*O*M2 si et seulement si M1∈Σ1 et M2∈Σ2.
Propriété : Dans l’axiome de Dedekind, le point O est unique.
Démonstration :
Supposons qu’il existe deux points O1 et O2 qui sont tous les deux des candidats pour être le point O tel que défini par l’axiome de Dedekind.
D’après l’axiome O2, il existe un point A, B, C de (d) tels que A*O1*O2, O1*B*O2 et O1*O2*C.
Sans perte de généralité, on peut prendre l’hypothèse que par exemple : A∈Σ2
A*O1*O2, O1*B*O2
Donc d’après l’axiome O1, on a : O2*O1*A, O2*B*O1
Donc O2*B*O1 et O2*O1*A
Donc d’après la propriété PO7, on a : B*O1*A
Donc d’après l’axiome O1, on a : A*O1*B
A∈Σ2, A*O1*B donc B∈Σ1
O1*B*O2, O1*O2*C
Donc d’après la propriété PO8, on a : B*O2*C
B∈Σ1, B*O2*C donc C∈Σ2
A*O1*B, O1*B*O2 donc d’après la propriété PO7, on a : A*B*O2
A*B*O2, B*O2*C donc d’après la propriété PO7, on a : A*B*C
Donc A∈Σ2, B∈Σ1, C∈Σ2 et A*B*C, ce qui contradictoire avec aucun point de Σ1 ne soit entre deux points de Σ2.
Donc nous avons bien l’unicité du point O dans l’axiome de Dedekind. CQFD
Propriété (C1,C2,C3,O3,PO3,PO5,PO7, Dedekind,PC1): Postulat d'Archimède
Si A≠B, E∈[AB), alors il existe un point C∈[AB) et un entier n tel que : n [AB] ≅ [AC] et E∈[AC].
Démonstration du Postulat d'Archimède :
Si E∈[AB], alors n=1 et C=B. C’est démontré !
Donc nous pouvons considérer que E∉[AB].
Posons A0 = A et A1 = B.
E∉[A0A1] car nous considérons que E∉[AB].
Puis construisons, la suite de points (An) suivante :
Pour tout entier n≥2, on a : An+1 est tel que A0*An*An+1 et [A0A1] ≅ [AnAn+1].
D’après l’axiome C1 et par récurrence, nous avons l’unicité et l’existence de cette suite de points.
Supposons que pour tout entier n≥2, E ∉ [A0An].
Posons Σ1={ M∈(A0A1) \ ∃n∈IN* M∈[A0An] }⋃[A1A0) et Σ2=(A0A1) \ Σ1
Montrons que Σ1 et Σ2 vérifient l’hypothèse de l’axiome de Dedeking.
E∉[AB]= [A0A1], et aussi pour tout entier n≥2, E ∉ [A0An].
donc E∉{ M∈(A0A1) \ ∃n∈IN* M∈[A0An] }
D’après l’axiome O3, entre les cas E*A0*A1, A0*E*A1, A0*A1*E un seul est possible.
E∉[A0A1] donc on ne peut avoir A0*E*A1,
et E∈[AB)=[A0A1) donc A0*A1*E
donc on ne peut avoir E*A0*A1
donc E ∉[A1A0)
donc E∉Σ1
E∈[AB)=[A0A1) donc E∈(A0A1)
E∉Σ1
donc E∈Σ2
donc Σ2 est une partie non vide.
A0∈Σ1
donc Σ1 est une partie non vide aussi.
Et par construction, on a : Σ1⋂Σ2= ∅.
Montrons que aucun point de Σ1 n’est entre deux points de Σ2.
Supposons qu’il existe Y1*X*Y2 tels que : Y1∈Σ2, X∈Σ1 et Y2∈Σ2
Y1∈Σ2
Σ2=(A0A1) \ Σ1
Σ1={ M∈(A0A1) \ ∃n∈IN* M∈[A0An] }⋃[A1A0)
donc Y1∉ [A1A0)
donc d’après l’axiome O3, on a : A0*A1*Y1
Y2∈Σ2
Σ2=(A0A1) \ Σ1
Σ1={ M∈(A0A1) \ ∃n∈IN* M∈[A0An] }⋃[A1A0)
donc Y2∉ [A1A0)
donc d’après l’axiome O3, on a : A0*A1*Y2
Donc si (d) est une droite passant par A1 et différente de (A0A1), alors d’après PO3 :
Y1 appartient au demi-plan (PY1,d) et A0 à l’autre (P’A0,d)
A0*A1*Y2 donc Y2∈(A0A1) et Y2∉[A1A0) donc d’après PO5, on a : Y2 ∈ (PY1,d).
A0,Y1 et Y2 appartiennent à la même droite et sont distincts car Y1*X*Y2 et Y1,Y2∉ [A1A0)
donc d’après l’axiome O3, on a : A1*Y1*Y2 ou Y1*A1*Y2 ou Y1*Y2*A1 un seul cas est possible.
Y1*A1*Y2 est impossible car Y1 et Y2 sont dans le même demi-plan (PY1,d).
Donc Y2∈]A1Y1)⊂ (PY1,d)
Donc [Y1Y2] ⊂ (PY1,d) et A1*Y1*Y2 ou Y1*Y2*A1
Donc [Y1Y2] ⊂ (PY1,d) et A1*Y1*Y2 ou A1*Y2*Y1
Y1*X*Y2 donc X∈[Y1Y2] ⊂ (PY1,d)
Et donc X∉[A1A0)
Mais X∈Σ1 donc il existe un entier n≥1 tel que X∈[A0An]
Si A1*Y1*Y2, comme Y1*X*Y2, alors d’après PO7, on aurait : A1*Y1*X.
donc Y1 ∈[A1An] ⊂ Σ1 Ce qui est impossible
Si A1*Y2*Y1, comme Y2*X*Y1, alors d’après PO7, on aurait : A1*Y2*X.
donc Y2∈[A1An] ⊂ Σ1 Ce qui est impossible
Donc aucun point de Σ1 ne soit entre deux points de Σ2.
Montrons que aucun point de Σ2 n’est entre deux points de Σ1.
Supposons qu’il existe X1*Y*X2 tels que : X1∈Σ1, Y∈Σ2 et X2∈Σ1
Y∈Σ2
Σ2=(A0A1) \ Σ1
Σ1={M∈(A0A1) \ ∃n∈IN* M∈[A0An] }⋃[A1A0)
Donc Y∉ [A1A0)
Donc d’après l’axiome O3, on a : A0*A1*Y
X1*Y*X2 donc Y∈[X1X2]
Si X1∈[A1A0) et X2∈[A1A0), alors Y∈[X1X2] ⊂[A1A0). Ce qui est impossible car Y∉[A1A0)
Donc X1∉[A1A0) ou X2∉[A1A0)
Donc choisissons X1∉[A1A0), le même raisonnement peut être fait pour X2∉[A1A0).
D’après l’axiome O3, on a : A0*X1*Y ou X1*A0*Y ou A0*Y2*X1 un seul cas est possible
1er cas : Si A0*Y2*X1 :
Comme X1∈Σ1, il existe un entier n≥1 tel que X1∈[A0An].
Y2∈[A0X1] ⊂ [A0An] ⊂ Σ1 Ce qui est impossible
2ième cas : Si X1*A0*Y :
D’après PO7, comme X1*A0*Y et X1*Y*X2, on a : A0*Y*X2
On sait que A0*A1*Y
Si X2∈[A1A0)\[A1A0], alors X2*A0*A1
Donc A0*A1*Y et X2*A0*A1, on aurait d’après PO7 : X2*A0*Y.
Ce qui est impossible d’après l’axiome O3.
Donc X2∈[A0A1)
Donc comme X2∈Σ1, il existe un entier n≥1 tel que X2∈[A0An].
Et A0*Y*X2 donc Y ∈[A0X2] ⊂ [A0An] ⊂ Σ1 Ce qui est impossible
3ième cas : si A0*X1*Y
D’après PO8, comme A0*X1*Y et X1*Y*X2, on a : A0*Y*X2
On sait que A0*A1*Y
Si X2∈[A1A0)\[A1A0], alors X2*A0*A1
Donc A0*A1*Y et X2*A0*A1, on aurait d’après PO7 : X2*A0*Y.
Ce qui est impossible d’après l’axiome O3.
Donc X2∈[A0A1)
Donc comme X2∈Σ1, il existe un entier n≥1 tel que X2∈[A0An].
Et A0*Y*X2 donc Y ∈[A0X2] ⊂ [A0An] ⊂ Σ1 Ce qui est impossible
Donc aucun point de Σ2 n’est entre deux points de Σ1.
Donc nous pouvons appliquer l’axiome de Dedekind : (A0A1) est donc la réunion Σ1 et Σ2 de deux parties non vides et telles que aucun point de Σ1 ne soit entre deux points de Σ2 et vice-versa, donc il existe un point F de (A0A1) tel que pour tous points M1 et M2 de (A0A1) autre que F, on ait M1*F*M2 si et seulement si M1∈Σ1 et M2∈Σ2.
Montrons que F ∈[A0E[.
Soit E’ un point de (A0A1) tel que A0*E’*E et [E’E] ≅ [A0A1].
E∉[A0A1] et E∈[A0A1) donc A0*A1*E
Donc d’après PC1, il existe E’ un point de (A0E) tel que A0*E’*E et [E’E] ≅ [A0A1].
Supposons que E’∈Σ1
Alors il existerait un entier n tel que E’∈[A0An]
Et donc [A0E’]<[A0An]
Donc il existe H tel que A0*H*An et [HAn] ≅ [A0E’]
[E’E] ≅ [A0A1] ≅ [AnAn+1]
Donc [HAn] ≅ [A0E’] et [AnAn+1] ≅ [E’E]
A0*H*An et A0*An*An+1 donc d’après PO7, on a : H*An*An+1
Et on a aussi A0*E’*E.
Donc d’après l’axiome C3, on a : [HAn+1] ≅ [A0E]
A0*H*An et A0*An*An+1 donc d’après PO7, on a : A0*H*An+1
Donc [HAn+1]<[A0An+1]
Donc d’après l’axiome C2, on a : [A0E]< [A0An+1]
Donc E∈Σ1 Ce qui est contraire à l’hypothèse.
Donc E’∉Σ1
Donc E’∈Σ2
Prenons maintenant un point E’’ tel que A0*E*E’’
Supposons que E’’∈Σ1
A0∈Σ1, E∈Σ2, E’’∈Σ1 Impossible car aucun point de Σ2 n’est entre deux points de Σ1.
Donc E’’∈Σ2
Et donc F n’est pas après E
Et en particulier :
A0*E’*E et A0*E*E’’ donc d’après PO7, on a : E’*E*E’’
Donc E ≠ F car si E = F, alors E’*E*E’’ => E’ et E’’ sont dans Σ1 et Σ2
Prenons enfin un point E’’’ tel que E’’’*A0*E
Supposons que E’’’∈Σ2
E’’’∈Σ2, A0∈Σ1, E∈Σ2 Impossible car aucun point de Σ1 n’est entre deux points de Σ2.
Donc E’’’∈Σ1
Donc F n’est pas avant A0
Donc F ∈[A0E[.
Pour finir remplaçons, E par F est recommençons tout ce raisonnement :
Par application de Dedekind nous trouvons un F’ tel que :
Pour Σ1’={ M∈(A0A1) \ ∃n∈IN* M∈[A0An] }⋃[A1A0) et Σ2’=(A0A1) \ Σ1’, F’∈[A0F[et pour tous points M1 et M2 de (A0A1) autre que F’, on ait M1*F*M2 si et seulement si M1∈Σ1’ et M2∈Σ2’
F’∈[A0F[
Donc A0*F’*F et A0*F*E, donc d’après PO7, on a : F’*F*E
Mais E∈Σ2, donc F’∈Σ1
F’ n’est pas avant A0
Donc il existe un entier n≥1 tel que F’∈[A0An]. Ce qui est impossible.
Le fait qu'un cercle et un segment de droite AB soient sécants signifie qu'il existe au moins un point qui appartient à la fois au cercle et au segment de droite. Dans cette démonstration, nous allons montrer qu'un tel point existe en utilisant l'axiome de Dedekind.
Premièrement, nous définissons ce qu'est un cercle. En géométrie euclidienne, un cercle est défini comme l'ensemble des points qui sont à une distance fixe (le rayon) d'un certain point (le centre). Nous allons utiliser cette définition pour notre démonstration.
Puis, nous avons les conditions suivantes :
Soit un cercle de centre O et de rayon R.
Soit un segment de droite AB avec le point A à l'intérieur du cercle et le point B à l'extérieur du cercle.
Nous allons prouver qu'il existe un point M sur le segment AB qui se trouve aussi sur le cercle.
La démonstration procède comme suit :
Considérez les points sur le segment AB comme étant divisés en deux ensembles, Σ1 et Σ2, selon qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle. Autrement dit, un point M sur AB appartient à Σ1 si la distance de M à O est inférieure ou égale à R (c'est-à-dire si M est à l'intérieur du cercle ou sur le cercle), et à Σ2 si la distance de M à O est supérieure à R (c'est-à-dire si M est à l'extérieur du cercle).
Il est clair que A appartient à Σ1 et B appartient à Σ2, donc Σ1 et Σ2 sont tous deux non vides.
De plus, aucun point de Σ1 n'est entre deux points de Σ2, et vice versa. En effet, si M1 et M2 sont deux points de Σ1, alors la distance entre O et tout point entre M1 et M2 ne peut pas être supérieure à R, donc aucun point de Σ2 ne peut être entre M1 et M2. De même, si N1 et N2 sont deux points de Σ2, alors la distance entre O et tout point entre N1 et N2 doit être supérieure à R, donc aucun point de Σ1 ne peut être entre N1 et N2.
Par conséquent, les conditions de l'axiome de Dedekind sont remplies pour le segment AB, Σ1 et Σ2. Par cet axiome, il existe donc un point unique O' sur le segment AB tel que pour tout point M sur AB autre que O', M est dans Σ1 si et seulement si A*O'M, et M est dans Σ2 si et seulement si MO'*B.
Ce point O' doit être à la frontière entre Σ1 et Σ2, donc la distance entre O et O' est exactement R, ce qui signifie que O' est sur le cercle. De plus, comme O' est sur AB, le cercle et le segment AB sont donc sécants au point O'.Haut du formulaire
Bas du formulaire
William BOURGES © 2023